actualité
Quelles solutions pour rapporter les roches martiennes sur Terre ? Entretien avec Francis Rocard
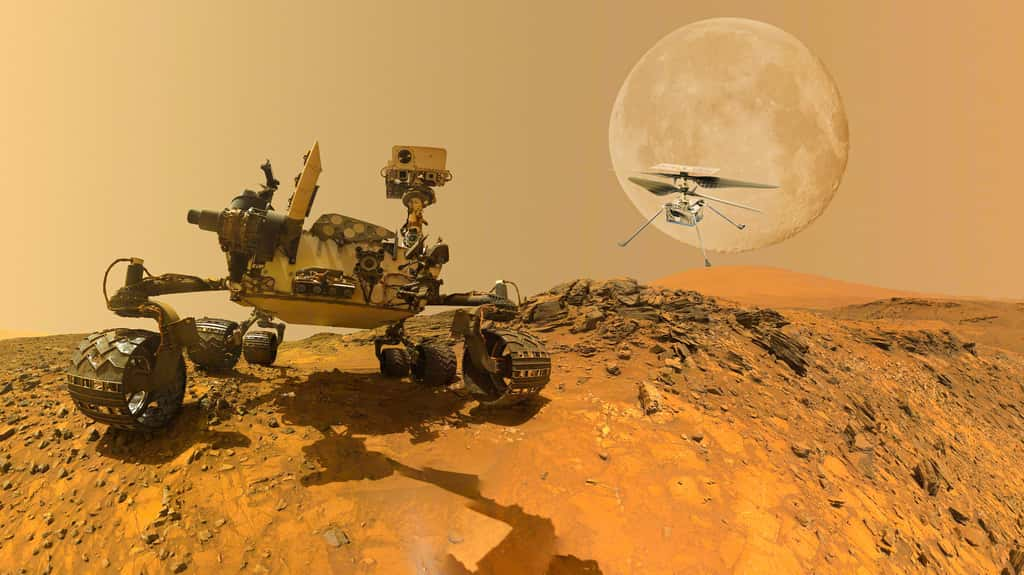
Francis Rocard, responsable des programmes d’exploration du Système solaire au sein du Cnes et spécialiste de Mars, nous résume les coulisses mouvementées de la mission de retour d'échantillons martiens. Cette entreprise complexe et coûteuse, menée par la Nasa et l’ESA, pourrait transformer notre compréhension de Mars et de l'existence de la vie passée sur cette planète.

Voilà plus de 20 ans que les scientifiques s’arrachent les cheveux sur la question de l’origine du méthane observé dans l’atmosphère de Mars, et plus spécifiquement dans le cratère Gale où séjourne actuellement le rover Curiosity. Sur la base d’expériences en laboratoire, une nouvelle étude pourrait cependant apporter des réponses. Celles-ci révèlent que le rover serait bien impliqué dans cette histoire mystérieuse !

Une étude remet en question la possibilité d'une vie sur Mars en suggérant que les paysages martiens, auparavant attribués à l'eau liquide, pourraient en réalité résulter de la sublimation de la glace de dioxyde de carbone. Cette étude met en lumière le rôle important du dioxyde de carbone dans la formation de structures martiennes, jetant le doute sur l'implication de l'eau dans ces processus.

Sur Mars, Perserverance continue son travail d’investigation. Des données acquises au cours de l’année 2022 viennent notamment de permettre aux chercheurs de reconstruire avec précision l’histoire géologique du cratère Jezero. Elles prouvent d’ailleurs qu’avant la formation du delta, le cratère était occupé par un lac calme.

Sciences
Espace
Mars : des structures qui ressemblent à des araignées et une « cité inca » photographiées à sa surface !
actualité
• 26/04/2024

Sciences
Espace
Mars : un indice que les conditions favorables à la vie ont duré plus longtemps qu’on ne le pensait
actualité
• 26/03/2024

Sciences
Mars
La Chine bientôt prête à récupérer des échantillons martiens ?
actualité
• 17/03/2024

Sciences
Mars
Spectaculaires éclipses de Soleil sur Mars filmées par un rover de la Nasa
brève
• 13/02/2024

Sciences
Mars
Perseverance fait un zoom sur Ingenuity mal-en-point pour comprendre ce qu'il lui est arrivé
brève
• 07/02/2024

Sciences
Ingenuity
Les triomphes du drone de la Nasa sur Mars en vidéo
brève
• 04/02/2024

Sciences
Mars
Un rover de la Nasa a trouvé un emblème de Star Trek sur Mars !
brève
• 26/01/2024

Sciences
Astronautique
Cet ancien fondateur de SpaceX propose un accès low cost au Système solaire
actualité
• 19/01/2024

Sciences
Mars
Une journée complète sur Mars ressemble à ça !
brève
• 03/01/2024

Sciences
Soleil
Une tache gigantesque sur le Soleil vue de Mars
brève
• 26/12/2023

Sciences
Mars
Mars : une activité volcanique récente suggère que la planète serait loin d’être morte
actualité
• 20/12/2023

Sciences
Mars
L’atmosphère de Mars a littéralement explosé sous l’effet d’un vide de vent solaire
actualité
• 14/12/2023

Sciences
Mars
Perseverance explore la surface de Mars depuis plus de 1 000 jours !
actualité
• 13/12/2023

Sciences
Mars
Voir Mars comme si vous y étiez en orbite ressemble à ça
actualité
• 29/11/2023

Sciences
Mars
D’étranges lueurs nocturnes détectées dans le ciel de Mars
actualité
• 10/11/2023

Sciences
Astronomie
Anniversaire de Carl Sagan, le pionnier de la communication avec les extraterrestres
actualité
• 09/11/2023

Sciences
Mars
Un rover de la Nasa vient de fêter un anniversaire particulier sur Mars !
brève
• 07/11/2023

Sciences
Colonisation de Mars
Voyage vers Mars : combien de temps faut-il pour y aller ?
question réponse
• 21/10/2023

Sciences
Exploration martienne
Récupérer les échantillons sur Mars : mission impossible pour la Nasa et l’ESA ?
actualité
• 16/10/2023

Sciences
Mars
Un magnifique coucher de Soleil bleu filmé sur une autre planète
brève
• 14/10/2023

Sciences
Mars
Perseverance a généré assez d’oxygène pour qu’un petit chien survive 10 h sur Mars
brève
• 06/10/2023

Sciences
Mars
Dans le ciel de Mars, l'hélicoptère Ingenuity n'a de cesse de surprendre !
brève
• 23/09/2023

Sciences
Astronautique
Idéfix, le rover le plus dingue jamais conçu, va explorer une lune de Mars !
actualité
• 10/09/2023

Sciences
Mars
Mars : deux images fantastiques d’Ingenuity et de Perseverance vus du ciel
brève
• 12/08/2023

Sciences
Mars
Curiosity franchit le plus grand obstacle de sa mission sur Mars
actualité
• 07/08/2023
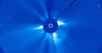
Sciences
Soleil
Nous venons d’échapper à une puissante éruption solaire qui aurait sonné les réseaux électriques
actualité
• 27/07/2023

Sciences
Mars
Des roches collectées par Perseverance suggèrent qu'il y a des molécules organiques sur Mars depuis des milliards d'années
actualité
• 17/07/2023

Sciences
Soleil
Le rover Perserverance a observé une tache solaire géante depuis Mars
brève
• 10/07/2023

Sciences
Mars
Perseverance et la Nasa ont retrouvé sur Mars le drone-hélicoptère Ingenuity
actualité
• 03/07/2023

Sciences
Mars
Mars : pourquoi le rover Zhurong ne détecte-t-il aucun champ magnétique ?
actualité
• 30/06/2023

Sciences
Mars
Perseverance est encore tombé sur un objet étrange sur Mars !
brève
• 27/06/2023
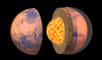
Sciences
Mars
Mars : son noyau liquide confirmé et de nouveaux mystères apparaissent
actualité
• 25/06/2023

Sciences
Astronautique
Curiosity nous envoie une sublime carte postale du paysage qu’il a sous les yeux
actualité
• 19/06/2023

Sciences
Mars
Une image spectaculaire et inédite de Mars pour célébrer les 20 ans de la sonde Mars Express
actualité
• 11/06/2023

Sciences
Mars
Un tremblement de terre sur Mars révèle les caractéristiques étonnantes de la croûte martienne
actualité
• 23/05/2023

Sciences
Astronomie
À Vulcania, le plus grand planétarium de France vous emmène sur les pentes des volcans martiens et vénusiens
actualité
• 09/05/2023

Sciences
Espace
Mars : des traces d’eau liquide récentes bouleversent notre vision de la Planète rouge
actualité
• 03/05/2023

Sciences
Mars
La Chine prévoit un hélicoptère pour sa mission sur Mars
brève
• 29/04/2023

Sciences
Mars
Ça se passe sur Mars : un rover photographié du ciel par un drone-hélicoptère !
brève
• 26/04/2023

Sciences
Mars
Évadez-vous sur Mars avec la carte la plus précise jamais réalisée publiée par la Nasa
actualité
• 07/04/2023

Sciences
Mars
Quel est le plan de la Nasa pour récupérer les échantillons de roches sur Mars ?
actualité
• 06/04/2023

Sciences
Mars
Mars : à quoi sont dues ces étranges dunes circulaires ?
actualité
• 11/03/2023

Sciences
Ingenuity
Mars : des images inoubliables du drone Ingenuity prises par Perseverance
brève
• 10/03/2023

Sciences
Mars
De magnifiques nuages colorés et iridescents photographiés dans le ciel de Mars pour la première fois
brève
• 08/03/2023

Sciences
Mars
Mars : la Nasa a photographié le rover chinois Zhurong qui ne bouge plus depuis plusieurs mois
actualité
• 22/02/2023

Sciences
Ingenuity
Mars : les secrets de la dynamique de la poussière résolus grâce à l’extraordinaire Ingenuity
actualité
• 19/02/2023

Sciences
Mars
Curiosity a découvert sur Mars une météorite métallique rare
brève
• 06/02/2023

Sciences
Mars
Une tête d’ours photographiée à la surface de Mars !
brève
• 30/01/2023